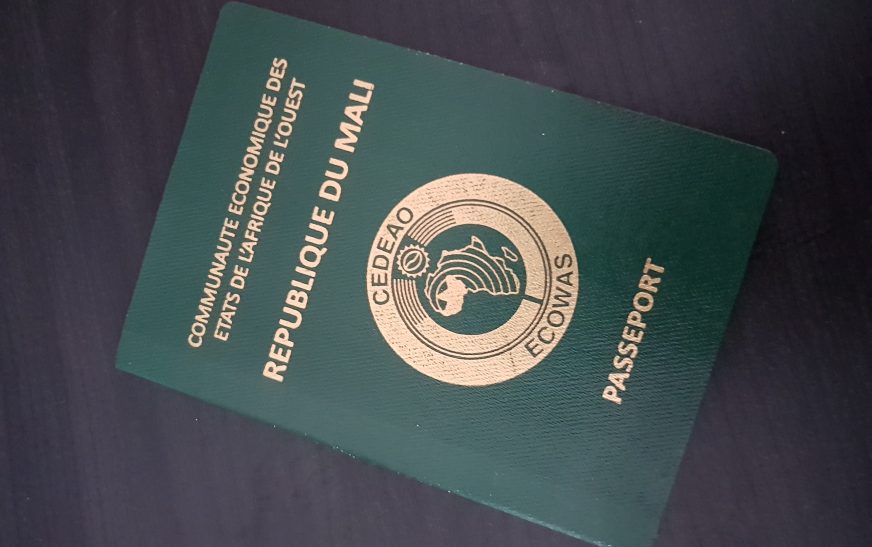Agée de 52 ans, Sokona est la femme derrière l’école Elites, installée dans le quartier de Sotuba à Bamako depuis 10 ans. Vivant en France, elle a pourtant décidé de revenir dans le pays qui l’a vue naître. Découvrez son histoire.
Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours ?
J’ai fait le lycée Akia Mohamed (Bamako, Mali). J’ai fait science et biologie, je voulais être paléontologue. Un jour, mon cousin cinéaste faisait un film, on a maquillé les acteurs, donc il a conseillé à ma mère de m’envoyer en France faire une école de maquillage artistique. C’est pour cette raison que je suis venue en France. Là-bas, j’ai connu mon mari, j’ai payé l’école, mais je n’ai pas continué. Je suis tombée enceinte de ma première fille, et je suis restée comme ça jusqu’en 2000. Après trois enfants, trois filles, je travaillais déjà. J’aidais les gens dans le quartier, ceux qui avaient des problèmes de papier, de sécurité sociale, de couple… Je leur expliquais les choses, je les aidais à faire leurs démarches administratives et un jour, je suis allée à la mairie et je leur ai demandé « Mais comment ça se fait que vous n’avez personne pour ces gens-là ? », et ils ont créé un emploi pour moi comme ça. A la mairie, dans le centre social. Après plusieurs formations, je suis devenue conseillère sociale.
Je travaillais en direction des familles issues de l’immigration, c’est-à-dire pas que les africains, mais toutes les familles qui venaient en France, qui n’étaient pas Françaises. Je les aidais à avoir leurs papiers, à avoir la sécurité sociale, à des fois aller au tribunal pour le juge des enfants, à la police pour traduire des choses, ou déposer quelqu’un pour porter plainte, intervenir parce que quelqu’un veut se suicider, parler avec. Et je suis tombée enceinte de mon quatrième enfant pendant que je travaillais au centre social. Donc du coup, il fallait arrêter de travailler, puisque je ne pouvais pas et travailler et m’occuper de mon enfant. Parce que quand je fais les choses, je ne les fais pas à moitié : soit je m’occupe de mon enfant, soit je travaille.
Ma directrice à l’époque a tout fait pour ne pas que je démissionne, car elle voulait que je prenne sa place, la remplacer quand elle partirait à la retraite… Non. Je ne pouvais pas. J’ai accouché, c’était un petit garçon, Dieu merci. Et je me suis rappelé de ma directrice qui me disait « Si tu veux travailler, je vais te trouver une place à la crèche. » C’était bien pour moi, j’étais pistonnée, mais je me suis dit qu’il y avait d’autres mamans qui voulaient travailler, mais elles n’avaient pas de mode de garde. Donc pourquoi ne pas ouvrir une crèche en France ? Mais c’était trop compliqué, il fallait tellement de choses… J’ai laissé tomber. Et quand on est venu en vacances au Mali en 2004, pendant mon congé parental, je me suis dit que je ferais une maternelle comme en France, ici à Bamako.
Au début c’était juste une pensée. J’avais dit ça comme ça. Mais après j’ai réfléchi : en France je me suis rendue compte que tu vas gagner ton argent, tu vas vivre normalement mais après ça tu ne peux rien faire d’autre. C’est-à-dire que tu es condamné à vivre avec ta paie, à l’époque je gagnais 1200 euros net, -c’était en 2000-, mon mari travaillait aussi, il gagnait environ 2000 euros. On était bien, on était dans la fourchette moyenne.
On était à deux doigts d’acheter une maison en France, quand ma grande sœur m’a dit «C’est trop cher, pourquoi tu n’investis pas au Mali ? » ça a fait tilt. J’étais sur le point de signer les papiers. En 2006, j’ai pris mes enfants, mais quand je leur disais personne ne me croyait (rires). Je leur disais « je vais faire mon école » et aucun d’eux ne me croyait.
Le retour
C’est comme ça que je suis arrivée ici au Mali. Chez moi. Ça a été très difficile au départ. C’est comme si je partais à l’aventure dans un pays inconnu puisque je vivais en France, c’est là-bas que j’ai eu mes enfants, je ne connaissais plus rien du Mali. Il a fallu que je me débrouille et que j’apprenne à patienter.
Se réadapter est très compliqué parce qu’ici il y a la famille et tu dois tout traiter avec. J’avais perdu cette habitude de discuter de tout avec ma famille, mais ici tout ce que tu fais, tu dois en faire part. C’est le respect. C’est le premier point. En second, il faut se mettre dans un moule, c’était trop compliqué pour moi de rester dans ce moule-là, c’est-à-dire les dimanches s’il y a des mariages, il faut y aller, ce n’est pas mon truc. Il ne faut pas s’habiller d’une façon… tout cela, je m’en foutais, je faisais comme je pouvais.
J’ai été la petite blanche, mais ici, quand tu viens commencer quelque chose, tant qu’on ne t’appelle pas comme ça, ça ne va pas fonctionner. Parce que tu sors de France, pour toi tu n’étais pas chez toi là-bas. Mais quand tu viens ici aussi tu ne te sens pas chez toi. Parce que les gens d’ici pensent que tu n’es plus des leurs. C’est trop compliqué. Il faut déjà accepter ce fait, que c’est vrai, que tu n’es plus des leurs, que tu ne penses plus comme eux, tu ne fais plus les choses comme eux… Si tu l’acceptes, tu peux avancer. Mais si tu veux faire comme si tu penses comme eux, tu ne peux pas.
Quand tu viens ici, tu apprends la patience. Parce qu’on est très lents. Quand on te dit que ce sera prêt dans 10 minutes, il faut compter trois ou quatre jours. Quand on te dit tout à l’heure, ça signifie mercredi ou jeudi. Ou ce week-end !
Entre l’idée d’une école et le jour de la rentrée des classes
J’ai eu de la chance, ça a été très rapide, ça a duré 6 mois. J’ai écrit le projet, rédigé des devis. Avec mon beau-frère qui est promoteur immobilier, on a dessiné les plans de l’école ensemble dans ma cuisine, en France ! On se disait voilà, on va faire ceci comme ça, on va mettre ça ici… C’était déjà bien, sinon ça allait être trop compliqué pour moi, je ne pouvais pas parce que même avec 5000 euros, je n’aurais pas pu faire un bâtiment de 100 millions de FCFA (environ 150000 euros). J’ai donc eu de la chance que mon beau-frère m’ait fait confiance, ai fait confiance en mon projet et m’a accordé un crédit. J’ai eu une nièce, une boule d’énergie, qui a effectué toutes les démarches administratives à ma place. Enfin, j’ai fait les décorations des salles moi-même.
Ce que notre école a de spécial, c’est le loisir éducatif. Dès la maternelle on apprend tout en jouant. La pratique du Français est un atout, car déjà pour comprendre les consignes, il faut déjà savoir bien parler la langue. Je le vois que ce n’est pas pareil, car j’ai parfois des élèves venant d’Europe, et pour tout vous dire ils ont souvent des 11… Quand le reste de la classe est à 13, 14 de moyenne. Comme ce n’est pas une école Française, à leur retour en France souvent les élèves sont contraints de passer un test de compétences, et jusque-là aucun ne l’a raté. Nous avons eu 100% de réussite au DEF (Diplôme d’études Fondamentales, équivalent du brevet des collèges en France), et nous comptons obtenir de meilleurs résultats à l’avenir.
Coups durs et difficultés
Les débuts ont été très très compliqués, on a fait trois, quatre ans, même sept sans atteindre les 100 élèves. Mais tout cela c’était bon, j’avais un crédit, mais au début on tourne à perte. Il faut payer les enseignants, (je faisais venir à l’époque des stagiaires en Français Langue Étrangère , que je payais et logeais moi-même), il faut payer le bâtiment, il faut payer les charges, mais on n’a pas beaucoup d’enfants. Il faut se donner à fond, avoir confiance en soi, et persévérer. Faire son travail avec passion et amour, avec la volonté de voir réussir les enfants.
La plus grosse difficulté au quotidien a été la séparation avec mon mari et mes enfants : Les enfants étaient petits, je faisais la navette entre Bamako et Paris jusqu’à sept aller-retour par an. C’était un coût, mais ma stabilité en dépendait. Je ne pouvais pas rester en France car il fallait faire grandir l’école, et je ne pouvais pas rester à Bamako car je devais voir grandir mes enfants. Ils ont d’ailleurs appelé l’école « mon 5e enfant », comme si c’était une petite sœur. A chaque retour, j’avais le cœur serré. Mais il fallait se ressaisir, et continuer à travailler.
Le gros coup dur, ça a été le coup d’état de mars 2012. A ce moment, j’avais beaucoup d’étrangers dans mon école, même des professeurs, et tout le monde est parti. Mais il fallait continuer de payer les enseignants, de payer les charges, de tout payer, mais tout le monde était parti. On a donc fait deux ans à perte comme ça, mais Dieu merci, ça va, ça commence à aller.
Aujourd’hui, on vient d’acquérir un nouveau bâtiment, et on a ouvert une crèche. Elites est donc à présent un groupe scolaire, jusqu’à la 9e (équivalent de la 3e) mais nous avons commencé en tant qu’école maternelle et primaire.
Quels conseils donnerais-tu à ceux qui veulent investir en Afrique ?
A quelqu’un qui veut entreprendre en Afrique, je lui dirais qu’il faut le faire. Il ne faut pas hésiter, il ne faut pas avoir peur. Les débuts vont être difficiles, mais il faut s’accrocher à son projet, à son rêve. Et persévérer.